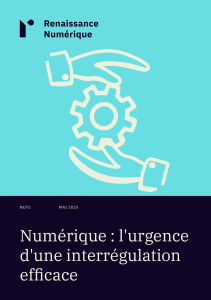Publication 14 mai 2025
Numérique : l’urgence d’une interrégulation efficace
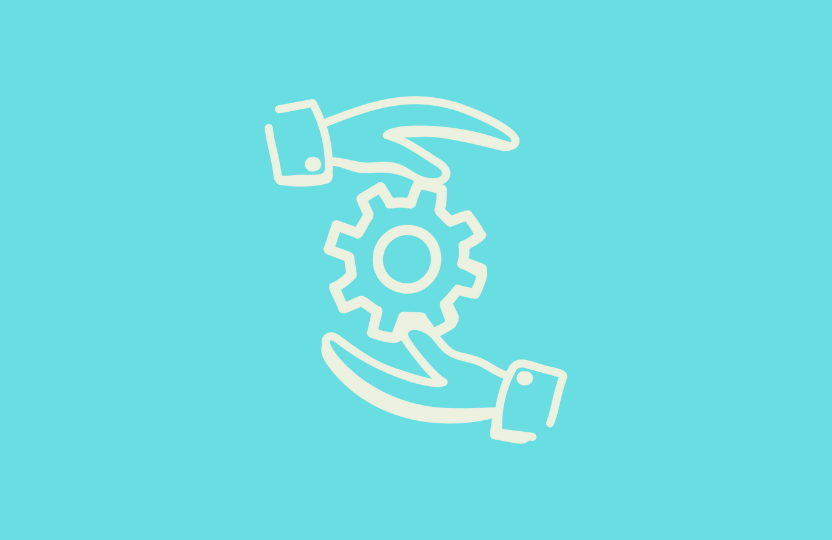
Résumé exécutif
Au tournant des années 2020, après une période marquée par le rôle structurant et exemplaire du Règlement général sur la protection des données (RGPD) instaurant une gouvernance relativement cohérente autour de la protection des données personnelles, l’Union européenne a amorcé une nouvelle phase, caractérisée par une adoption rapide de nouveaux textes. Entre 2022 et 2024, cinq règlements majeurs (Data Governance Act, Digital Markets Act, Digital Services Act, Data Act, AI Act) ont été adoptés, chacun poursuivant des objectifs spécifiques, souvent complémentaires mais rarement coordonnés. Cette profusion normative a fait émerger des tensions nouvelles dans la mise en œuvre de ces dispositifs, notamment du fait de leur chevauchement avec les obligations issues du RGPD.
Cet étoffement des normes s’est accompagné d’un bouleversement institutionnel. Là où le RGPD pouvait s’appuyer sur des autorités uniques (les autorités de protection des données) et sur une coordination européenne solide via le Comité européen de la protection des données (CEPD), les nouveaux textes appellent à une régulation multisectorielle. La pluralité des autorités impliquées – qu’il s’agisse de la concurrence, de la consommation, des médias ou encore de la sécurité – rend nécessaire une coopération structurée, aujourd’hui encore balbutiante. La logique d’“interrégulation” s’impose, mais peine à se concrétiser dans un système qui n’a pas été pensé pour cela.
La complexité ne se limite pas aux échelons nationaux. Au niveau européen, la multiplication des comités et des instances de comitologie liés à chaque texte rend difficile la cohérence d’ensemble. Contrairement au CEPD, ces nouvelles structures n’ont pas l’historique de coopération nécessaire pour harmoniser les pratiques. En parallèle, la Commission européenne a renforcé ses prérogatives en matière de mise en œuvre, notamment via l’adoption d’un nombre croissant d’actes délégués, recentralisant ainsi une part du pouvoir normatif au détriment des autorités nationales.
Face à ce paysage fragmenté, les États membres doivent adapter leur gouvernance. En France, la réponse à cette dispersion a été la constitution progressive d’un réseau de coordination, officiellement introduit par la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (SREN). Ce choix repose à la fois sur des considérations pratiques – la spécialisation des régulateurs sectoriels – et sur un héritage institutionnel peu propice à la centralisation. En parallèle de cette diversification des autorités impliquées s’opère une montée en puissance de certaines administrations (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) et Direction générale des entreprises (DGE), notamment).
Dans ce contexte, la régulation évolue également dans sa nature. Elle passe d’une logique essentiellement réactive, fondée sur le traitement des incidents, à une approche plus préventive, inspirée de la régulation concurrentielle classique. Cette transformation suppose non seulement une meilleure coordination des actions, mais aussi une convergence des cultures entre autorités, parfois marquées par des traditions juridiques et opérationnelles très différentes.
Enfin, un autre enjeu majeur émerge : celui de la compétence. La complexification du cadre réglementaire européen appelle une montée en puissance des expertises, tant au sein des instances de pouvoir et des administrations que dans les entreprises et la société civile. L’Europe ne pourra soutenir une régulation ambitieuse que si elle s’appuie sur des viviers de professionnels formés, capables de maîtriser les enjeux croisés de la donnée, de l’IA et de la gouvernance du numérique.
La régulation du numérique ne peut plus reposer sur les ressorts qui ont fait le succès du RGPD. Elle exige désormais un modèle plus complexe, plus coordonné. L’enjeu est double : préserver l’ambition normative européenne face aux pressions internationales croissantes visant à une dérégulation, tout en garantissant une mise en œuvre efficace et lisible pour l’ensemble des acteurs concernés.
Afin de répondre à ce double enjeux, Renaissance Numérique formule dix propositions pour une meilleure régulation du numérique en France.
PROPOSITIONS
PROPOSITION 1
PROPOSITION 2
PROPOSITION 3
PROPOSITION 4
PROPOSITION 5
PROPOSITION 6
PROPOSITION 7
PROPOSITION 8
PROPOSITION 9
PROPOSITION 10
Renaissance numérique tient à remercier l’ensemble des dirigeants d’autorités et d’administrations et les experts interrogés dans le cadre de cette étude :
-
Sarah BÉNICHOU, Directrice, Défenseur des droits
-
Hélène BONNET, Directrice de projets Politiques publiques et relations institutionnelles, Pôle d’expertise sur la régulation du numérique (PEReN)
-
Benoît COEURÉ, Président, Autorité de la concurrence (AdlC)
-
Matthieu COURANJOU, Délégué à la régulation des plateformes numériques, Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC)
-
Nicolas DEFFIEUX, Directeur, Pôle d’expertise sur la régulation du numérique (PEReN)
-
Laure DE LA RAUDIÈRE, Présidente, Arcep
-
Marie-Laure DENIS, Présidente, Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
-
Gabrielle DU BOUCHER, Chargée de mission numérique, droits et libertés, Défenseur des droits
-
Claire HÉDON, Défenseure des droits
-
Sarah LACOCHE, Directrice, Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF)
-
Armand LACOMBE, Chargé de mission IA, Direction Générale des Entreprises (DGE)
-
Clara-Lou LAGARDE, Cheffe du département Supervision et coordination nationale, Direction des plateformes en ligne, Arcom
-
Rodolphe LE RUYET, Conseiller technique de la Présidente, Arcep
-
Benoît LOUTREL, Membre du collège, Arcom
-
Roch-Olivier MAISTRE, Président, Arcom
-
Sébastien MONTAIGU, Adjoint au Délégué à la régulation des plateformes en ligne, Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC)
-
Lucille PETIT, Directrice des plateformes en ligne, Arcom
-
Chantal RUBIN, Cheffe du pôle Régulation des plateformes numériques, Direction Générale des Entreprises (DGE)
-
Rémi STEFANINI, Délégué à la transition numérique, Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF)