Publication 30 septembre 2025
Synthèse – Numérique : l’urgence d’une interrégulation efficace
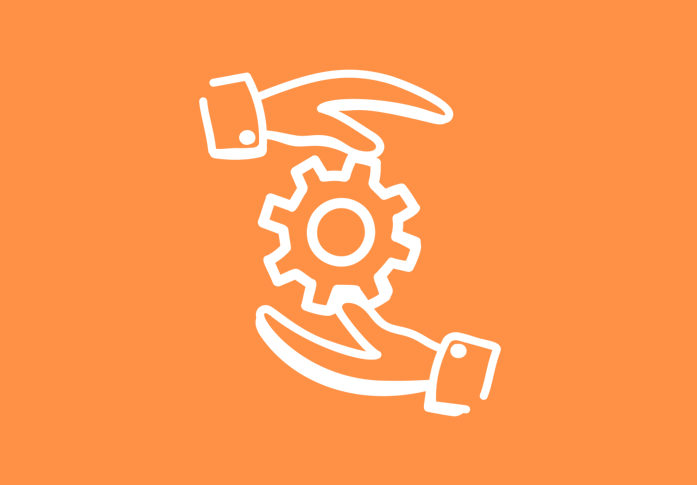
Contexte du webinaire
Dans une note intitulée « Politique numérique de l’UE : l’heure de la cohérence a sonné », parue en novembre 2024, Renaissance Numérique mettait en lumière les défis d’articulation grandissant entre les réglementations visant à encadrer les technologies et les usages numériques. Dans la lignée de ces réflexions, le think tank a publié une note intitulée « Numérique : l’urgence d’une interrégulation efficace » en mai 2025.
Celle-ci présente l’évolution de la régulation européenne du numérique depuis l’avènement du règlement général sur la protection des données (RGPD), et questionne l’état de l’interrégulation en France. Renaissance Numérique dresse le constat selon lequel la régulation du numérique ne peut plus reposer sur les ressorts qui ont fait le relatif succès du RGPD. Elle exige désormais un modèle plus complexe et coordonné. Afin de préserver l’ambition normative européenne face aux pressions internationales croissantes visant à une dérégulation, et de garantir une mise en œuvre efficace et lisible pour l’ensemble des acteurs concernés, le think tank a formulé 10 propositions.
Pour en discuter, Renaissance Numérique a organisé le 23 juin dernier un webinaire en présence de :
- Jeremy Bonan, directeur adjoint des plateformes en ligne à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).
- Thomas Dautieu, directeur de l’accompagnement juridique à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
- Rodolphe Le Ruyet, conseiller technique de la Présidente à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).
- Chantal Rubin, cheffe du pôle régulation des plateformes numériques de la Direction générale des Entreprises (DGE).
- Jean-Luc Sauron, haut fonctionnaire d’État et auteur principal de la note, membre du Conseil d’administration de Renaissance Numérique.
- Rémi Stefanini, délégué à la transition numérique à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Ils ont chacun partagé leurs perspectives et retours d’expérience, notamment sur les moyens de garantir une interrégulation efficace tant sur le plan national qu’européen. Cette synthèse retrace leurs échanges.
RAPPEL DES 10 PROPOSITIONS
PROPOSITION 1
PROPOSITION 2
PROPOSITION 3
PROPOSITION 4
PROPOSITION 5
PROPOSITION 6
PROPOSITION 7
PROPOSITION 8
PROPOSITION 9
PROPOSITION 10
La profusion de textes complexifie la régulation
La récente profusion des textes législatifs européens encadrant le numérique (notamment sur la période 2022-2024) fait consensus entre les intervenants quant à sa nécessité, mais soulève également des interrogations sur ses effets en termes de complexité juridique, de gouvernance et de mise en œuvre. Ce constat n’est pas un jugement de valeur, il peut même être lu comme la prise de conscience progressive des enjeux liés aux grandes plateformes numériques par les acteurs politiques. À ce titre, Rodolphe Le Ruyet (Arcep) rappelle qu’ : « il a fallu contribuer à la prise de conscience du besoin d’intervention ciblée sur quelques géants du numérique qui posent des problèmes à notre économie et plus généralement à nos sociétés ». À ses yeux, loin d’être un obstacle, cet ensemble de textes constitue un tournant historique dans la régulation numérique, marqué par des textes majeurs tels que le règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act ; DMA), le règlement sur les services numériques (Digital Services Act ; DSA), le Règlement sur la gouvernance des données (Data Governance Act) ou encore le Règlement sur les données (Data Act). Rémi Stefanini (DGCCRF) appuie ce constat, soulignant que face à des acteurs de taille mondiale, seule une action européenne concertée et juridiquement encadrée permet d’avoir le poids nécessaire pour avoir un impact significatif sur leurs pratiques. Cependant, cette multiplication législative entraîne une réelle complexification du paysage réglementaire, tant pour les autorités que pour les acteurs régulés. Thomas Dautieu (CNIL) insiste sur la difficulté croissante pour les citoyens et les entreprises de naviguer dans cette complexité : « La multiplicité des textes, même si elle se justifie, conduit à une multiplication des régulateurs. Tout cela entraîne une forme de complexité ».
Jeremy Bonan (Arcom) relève par ailleurs que l’usage de l’expression « âge d’or », telle qu’elle est utilisée dans la note de Renaissance Numérique, peut laisser penser qu’il aurait existé une période idéale où seul le RGPD existait, et que la période actuelle pourrait être perçue en contraste avec celle-ci. Jean-Luc Sauron (Renaissance Numérique) précise que la volonté du groupe de travail était plutôt de souligner le passage d’un « monde relativement stable à un moment où il y a une mise en mouvement concertée et parallèle de textes, certes intéressante, mais qui s’annonce sans doute compliquée ».
| Proposition n°3 :
Lancer une plateforme unique pour le signalement des incidents en relation avec l’application des textes du paquet numérique. Thomas Dauthieu (CNIL) apporte un soutien appuyé à l’idée d’une plateforme unique, qu’il considère comme une réponse nécessaire à la complexification croissante du paysage réglementaire numérique. Il souligne que cette complexité affecte tous les acteurs : régulateurs, entreprises régulées et citoyens, créant une « forme de déstabilisation » systémique. Son analyse va au-delà du simple signalement d’incidents pour englober une vision plus large d’orientation réglementaire. Il valorise l’idée d’un « point d’entrée unique » permettant de clarifier « qui fait quoi, qui est compétent, qui peut m’aider », s’inspirant du succès observé dans le milieu de la santé. Il illustre concrètement les dysfonctionnements actuels avec l’exemple des notifications de violations de données, où les acteurs doivent s’adresser simultanément à la CNIL, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), le ministère de la Santé ou l’Autorité des marchés financiers (AMF) selon les secteurs. Il explique : « Quand vous avez une violation de données, une crise émerge chez les acteurs. Il faut donc factoriser un certain nombre de procédures ». Sa contribution enrichit la proposition en démontrant que la centralisation ne vise pas à « abaisser le niveau de régulation, mais faire en sorte que tous les régulateurs puissent avoir la même information, par un canal centralisé ». Il positionne ainsi la plateforme comme un outil d’efficacité réglementaire plutôt que de simplification administrative. |
| Proposition n°6 :
Mieux articuler les différents niveaux de la régulation du numérique en Europe. Rémi Stefanini (DGCCRF) estime que cette proposition représente un enjeu majeur pour la mise en œuvre des réglementations. La DGCCRF est principalement concernée par le commerce électronique. La Commission européenne y joue de plus en plus un rôle prépondérant : « On voit qu’il y a des ponts entre les compétences de la Commission et celles de la DGCCRF, qui achète et teste des produits sur des plateformes régulées également par la Commission au titre du DSA. Cela devient vraiment très important de pouvoir travailler main dans la main avec la Commission sur ces nouvelles réglementations ». Rodolphe Le Ruyet (Arcep) abonde et met en évidence la transformation majeure du rôle de la Commission européenne dans la régulation du numérique, qui évolue d’une fonction traditionnelle de contrôle de la transposition des textes par les États membres vers une compétence de régulation directe des objets numériques, notamment illustrée par le « DSA/DMA package ». Cette mutation nécessite désormais une amélioration de la coopération entre les niveaux national et européen pour gérer efficacement cette nouvelle répartition des compétences réglementaires. Jeremy Bonan (Arcom) met en garde contre la complexité émergente de cette évolution, expliquant que « c’est là où il y a une nouvelle complexité, car il y a des organisations de répartition des compétences qui ne sont pas du tout uniformes ». Chaque texte développe sa propre logique de fonctionnement, créant une hétérogénéité dans l’architecture réglementaire européenne. Rémi Stefanini (DGCCRF) estime que cette centralisation permet d’agir collectivement au niveau européen face aux grands acteurs internationaux. Cette approche répond à une logique d’échelle : certains acteurs étant « trop gros » pour une régulation nationale efficace, la Commission hérite d’une mission de régulation « en notre nom à tous ». |
Le nécessaire renforcement de la coordination entre acteurs
La nécessité d’une meilleure coordination entre autorités et administrations est largement partagée, conformément à la proposition N°4 du rapport de Renaissance Numérique « Dépasser la concertation informative pour aller vers une collaboration plus opérationnelle des différentes autorités et administrations de l’interrégulation » (page 34 de la note). Chantal Rubin (DGE) précise : « Il y a de la valeur ajoutée, de la synergie à produire. Le réseau des régulateurs en cours d’élaboration vise précisément à développer des coopérations plus concrètes, portant sur des outils communs, des procédures ou des lignes directrices », afin de renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action publique. Jean-Luc Sauron (Renaissance Numérique) précise que l’objectif n’est pas de « créer une structure unique », mais de favoriser une convergence opérationnelle.
Pour Thomas Dautieu (CNIL), la régulation du numérique ne peut en effet se faire par le biais d’un seul régulateur, mais bien par une coopération des différentes autorités. « Il n’est pas très raisonnable de croire en une sorte de régulateur unique, qu’il soit au niveau français ou au niveau européen. Je trouve que c’est plutôt intelligent d’avoir raisonné à périmètre constant par rapport aux organes de régulation existant ». À titre comparatif, l’Allemagne a mis en place une autorité ayant pour objet de superviser la totalité des textes (page 19 de la note). Toutefois, précise-t-il, il n’est pas favorable d’avoir une multiplication des régulateurs, car cela rendrait la coordination et la compréhension entre autorités plus difficile. Rémi Stefanini (DGCCRF) abonde dans le sens du renforcement d’une coordination entre les autorités existantes plutôt que la construction d’une autorité unique.
Cette coordination nécessaire s’appuie sur des dialogues déjà établis entre les différentes autorités. Thomas Dautieu (CNIL) met en avant l’exemple européen, où existent « des relations extrêmement fortes avec les homologues européens, avec le secrétariat du CEPD » et « un dialogue quasi-quotidien avec les instances qui vont bien à Bruxelles ». Cependant, il reste prudent sur une mutualisation trop poussée au niveau national, rappelant que les régulateurs répondent à « des textes, des modes de régulation et des objectifs différents ». Rodolphe Le Ruyet (Arcep) souligne l’importance d’une spécificité sectorielle en prenant exemple sur l’Arcep qui est un régulateur de nature économique. Cette identité n’empêche pas des échanges variés avec les autres régulateurs, « qu’ils soient formels, informels, bilatéraux, multilatéraux », qui peuvent déboucher sur des « actions parfois communes même », comme entre l’Arcom et l’Arcep. Chantal Rubin (DGE) insiste quant à elle sur l’importance d’un dialogue bidirectionnel entre régulateurs et décideurs politiques : les régulateurs qui « pratiquent et ont l’expérience et la praxis de la régulation du numérique peuvent éclairer les décisions des autorités politiques et les décideurs politiques peuvent à leur tour sensibiliser les régulateurs sur de nouveaux challenges exprimés par la collectivité ». L’objectif est de « dépasser un peu aujourd’hui le stade de la collaboration informative, pour aller véritablement vers une collaboration beaucoup plus opérationnelle ».
| Proposition n°2 :
Faciliter la reprise d’informations issues des procédures d’enquête des différentes autorités et administrations de la régulation du numérique. Jeremy Bonan (Arcom), souligne l’existence d’un enjeu majeur dans la mise en œuvre opérationnelle de l’interrégulation. Il met en exergue le fait que les procédures d’enquête et les pouvoirs de sanction fonctionnent très différemment en fonction du ministère de rattachement ou de l’autorité indépendante. Cette hétérogénéité ne se limite pas aux seules relations inter-institutionnelles, mais s’observe également au sein même des autorités indépendantes. Il prend l’exemple de sa propre institution : « Au sein de l’Arcom il y a un collège unique et pour les procédures formalisées, on doit faire appel aux rapporteurs indépendants, ce qui n’est pas le mode de fonctionnement qu’on trouve dans d’autres autorités ». Au-delà de cette diversité organisationnelle, il insiste particulièrement sur les enjeux de sécurisation juridique et de coopération inter-autorités : « Il est essentiel de sécuriser les procédures à plusieurs niveaux : d’abord, garantir la fiabilité des échanges d’informations lors des coopérations entre autorités ; ensuite, s’assurer que ces procédures respectent les droits fondamentaux. L’objectif est d’éviter les situations de fragilité juridique où une autorité se voit contester son droit de sanction en raison de défaillances procédurales, notamment lorsque ces défaillances résultent de recommandations textuelles inadéquates ». Cette préoccupation trouve un écho dans les propos de Jean-Luc Sauron (Renaissance Numérique) qui alerte également sur les « stratégies contentieuses […] qui commencent à être un peu lourdes » au niveau européen, plaidant pour une circulation fluide de l’information entre autorités afin de limiter les contentieux. |
Les défis de l’hétérogénéité des acteurs
Rodolphe Le Ruyet (Arcep) rappelle que l’hétérogénéité des acteurs est une réalité « puisque les régulateurs se sont vu confier par le Parlement des responsabilités, des objectifs de politique publique qui sont différents ». L’Arcep doit par exemple « apporter la connectivité fixe, mobile, pour les Français, et maintenir ouverte la concurrence dans les télécoms ». Les missions des régulateurs (Arcom, Arcep, CNIL, DGCCRF) sont diverses et variées. La DGE est quant à elle une administration ou « un service d’État » comme le rappelle Chantal Rubin (DGE), dont la mission est de porter une vision stratégique auprès des autorités qui mettent en place la loi (Gouvernement, Parlement), contrairement aux régulateurs qui l’appliquent.
Chaque acteur a une culture différente, ce qui demande pour Chantal Rubin une meilleure culture de l’interdisciplinarité, qu’elle n’estime pas encore assez partagée. Rodolphe Le Ruyet (Arcep) nuance ces propos en estimant que beaucoup d’acteurs au sein des régulateurs et administrations sont passés par la plupart des autorités, ce qui facilite le dialogue et la compréhension entre eux. De plus, cette interdisciplinarité s’illustre de façon concrète dans les projets communs menés par les différentes autorités, notamment en matière d’impacts environnementaux du numérique. Il illustre ses propos en évoquant le référentiel général de l’éco-conception des services numériques, qui est « une production collective, élaborée conjointement par l’Arcep, l’Arcom, l’ADEME, la CNIL et d’autres acteurs, et qui témoigne de la capacité des autorités à dépasser leurs périmètres respectifs pour traiter des enjeux transversaux ». Il rappelle également que « la France et les autorités françaises, de manière relativement collective, ont avancé en matière de mesures et de caractérisation et de limitation des impacts environnementaux du numérique ». Cette avancée française pourrait selon lui être une « belle opportunité » pour constituer un modèle à l’échelon européen.
Régulation et innovation
| Proposition n°8 :
Mesurer et intégrer les coûts et impacts de la régulation pour les entreprises. Rodolphe Le Ruyet (Arcep) défend l’idée que la régulation constitue un levier plutôt qu’un frein, car « sans régulation, pas d’innovation et pas de concurrence ». Il rappelle la distinction entre régulation et réglementation, considérant que « la régulation, c’est l’idée d’accompagner un marché pour que les intérêts privés de ces acteurs rencontrent l’intérêt général ; elle permet l’arrivée de challengers, l’ouverture du marché, l’innovation ». Jean-Luc Sauron (Renaissance Numérique) souligne l’importance de disposer de chiffres et d’indicateurs pour répondre aux discours anti-régulation pour contrer les discours qui prônent que « tout cela n’a pas d’utilité et représente un coût ». |
Les enjeux de former les acteurs de la régulation
| Proposition n°9 :
Créer un diplôme européen d’expertise transversale sur les différentes questions liées au numérique. Jean-Luc Sauron (Renaissance Numérique) évoque l’importance de cette proposition et affirme « être vraiment inquiet […] sur le manque de vivier professionnel compétent ». Il alerte sur l’absence de préparation à grande échelle face aux défis numériques à venir, notamment au niveau local car « rien n’est fait pour préparer les collectivités à ce contentieux ». Rémi Stefanini (DGCCRF) confirme que « le sujet des compétences en numérique est effectivement un sujet majeur » et souligne que son administration doit « faire de plus en plus de contrôles numériques pour accompagner la montée en puissance du numérique dans l’économie », nécessitant un « gros travail de renforcement du volet numérique dans la formation ». Rodolphe Le Ruyet (Arcep) décrit les défis de recrutement d’experts en intelligence artificielle, cloud et data scientists, précisant qu’il y a « un véritable enjeu de montée en compétences et de maintien des compétences dans un moment où il y a des évolutions technologiques importantes ». Il estime que « l’idée d’un diplôme européen apporterait des éléments de réponse à cela », insistant sur la nécessité de couvrir à la fois les aspects techniques et législatifs. Thomas Dautieu (CNIL) propose une approche complémentaire axée sur la mutualisation des moyens. Il souligne que « l’interrégulation mène à la limite des compétences techniques, financières, budgétaires que les autorités peuvent avoir, d’où l’intérêt de factoriser des moyens ». Il valorise l’exemple du PEReN « qui de bénéficier de compétences sans avoir à recruter des ingénieurs qu’il n’est pas possible de payer ou de fidéliser ». Il ne s’agit pas, selon lui, de « fondre les régulateurs entre eux, mais de leur donner des moyens leur permettant de s’appuyer sur des compétences que les régulateurs n’auront pas et n’auront certainement jamais ». |
Sur le même sujet
-

Publication 14 mai 2025
Numérique : l'urgence d'une interrégulation efficace
-
Événement

Webinaire "Numérique : l'urgence d'une interrégulation efficace"
Lundi 23 Juin 2025, 14h-15h30
En ligne


